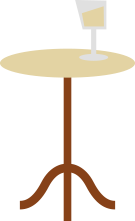Stage: communicatie & sociale media
13 Maa 2024
vr 01 sep 2017
Ce soir Fabrice Murgia va intervenir pour le discours du State of the Union à l’ouverture du Theater Festival. C’est la première fois qu’un artiste francophone est invité. Quel message fort est-il important de faire passer ? Et quelle(s) sont ses attente(s) quant à la programmation du Theater Festival ? Fabrice nous dévoile aussi les innovations de la nouvelle saison du Théâtre National.
Elise Pierre

@Jérome Van Belle
Le TheaterFestival existe depuis 1987, après avoir était un temps une collaboration flamande et néerlandaise, aujourd’hui il relie les villes de Bruxelles et d’Anvers qui hébergent tous les deux ans la programmation. Fabrice tu as été invité cette année à prononcer un des discours d’ouverture du festival… un symbole fort selon toi donné au théâtre belge et à la communauté wallonne ?
C’est un geste d’ouverture fort de la part du TheaterFestival, auquel je tenais à répondre en invitant de nouveau à l’ouverture. Il est clair qu’on voit de plus en plus des gestes d’ouverture dans ce sens là mais, malheureusement, ils ne parviennent pas à dépasser le stade de la communication. C’est ce vers quoi il nous faut encore travailler pour combattre la croissance du populisme et du nationalisme. C’est un des rôles primordiaux des politiques culturelles à venir. S’échanger un ou deux artistes par années n’est pas suffisant. La culture ne donne pas dans le marketing. Il est urgent de passer à l’internationalisation des
équipes et des plateaux. Je veux dire par là qu’un éclairagiste ou un dramaturge du KVS puisse venir participer à une création du Théâtre National et vise versa.
Les premiers spectacles surtitres en Belgique, on été introduit par le Kunstenfestivaldesarts. C’était dans le début des années 2000… Est-ce que pour autant cela a rendu les programmations flamandes et wallonnes plus ouvertes l’une envers l’autre ?
Non. Je pense que même s’il y a des surtitres de plus en plus dans les différents théâtres, on est resté quand même à des timides explorations des territoires l’un de l’autre. Si j’ai la chance de travailler avec le LOD muziektheater et de jouer en Flandre, c’est bien parce que les productions que je fais sont flamandes. De la même manière, on a vu des néerlandophones qui jouaient leurs spectacles en Français ou encore des acteurs, des actrices, comme Vivianne De Muynck qui peuvent jouer dans les deux langues indifféremment, ce qu’on a moins du côté francophone. On a pris un train de retard sur la transdisciplinarité. Les enfants de Jan Decorte ont été largement accompagnés par les politiques flamandes. Ce qui leur a permis de jouer plus chez nous que l’inverse. En Flandre, on a considéré ces artistes comme des ambassadeurs, Wim Vandekeybus, Jan Fabre, Jan Lauwers, tandis qu’en Wallonie on a pas du tout adopté la même politique. La Flandre a même été jusqu’à coproduire le Festival
d’Avignon pour y avoir sa place. Je n’enlève rien à l’innovation qu’amenaient ces gens, parce que ce sont des génies qui ont réellement leur place sur scène, mais je souligne simplement les contextes opposés dans lequel chaque génération d’artistes a grandit. Aussi on était victime d’un cliché du côté francophone, le cliché du « théâtre français », que nous avons même nous même sur le théâtre français, qui est, une espèce de chose qui tourne autour du texte, du fardeau du « bien dire » que l’on se trimballerait sur le dos. Je suis certain qu’on peut attraper un spectateur flamand sur deux qui ne sera pas que le Théâtre National a une programmation progressiste et non conservatrice.
En deux mots, peux-tu nous dire tes attentes quant à la programmation du TheaterFestival, cette année ?
J’aime l’éclectisme de cette programmation. On peut à la fois y voir de jeunes artistes et des spectacles de Anne Teresa De Keersmaeker. Ça a toujours été la force du TheaterFestival et je n’en attend pas moins que les autres années.
Pour cette deuxième saison en tant que directeur, tu as souhaité apporter quelques innovations dans le rapport au public. A côté de la programmation habituelle, tu as crée une « saison libre ». Qu’elle est la valeur ajoutée de cette proposition ?
Un théâtre n’est pas qu’une salle de spectacle avec des sièges, mais une agora citoyenne. En y valorisant au même titre que les spectacles, des activités ou disciplines différentes, voir des débats d’idées, des conférences, on fait venir des autres publics. Cela participe à une stratégie d’élargissement des publics et ce n’est pas que de la communication et du marketing, c’est aussi la conviction profonde qu’un théâtre, le lieu physique, est un espace citoyen.
Le Théâtre National se donne également la possibilité de filmer les artistes en « backstage ». Une manière de dissoudre complètement le filtre du quatrième mur ou d’introduire le hors champ du cinéma au théâtre ? Où se place ton ambition ?
Mon envie c’est d’intéresser les gens à la manière dont on cuisine les spectacles, à la manière dont on les fabrique. D’une part cela participera au fait de sauvegarder notre profession, à démonter les clichés qui l’entoure et aussi peut-être à sauver les métiers qui fabriquent le théâtre et qui sont en danger. Je parle des métiers traditionnels, des techniciens, mais aussi des modes de production, des rythmes de production. Je pense qu’intéresser le public dans ma ligne de communication à la manière dont on fabrique les spectacles participera à démonter ces clichés là.
Ta compagnie, Artara, a été crée alors que tu étais artiste associé du Théâtre National sous la direction de Jean-Louis Colinet. Est-ce toujours l’ambition du Théâtre National aujourd’hui d’accompagner les jeunes artistes et quels formes cela prend t-il? C’est important aujourd’hui pour eux de pouvoir être associés à un théâtre ?
C’était le cheval de bataille du second mandat de Jean-Louis Colinet, dont je suis en quelque sorte un laboratoire, avec ma compagnie et mon spectacle, Le Chagrin des Ogres. Il a cherché à plusieurs reprises à répéter l’initiative, en y parvenant certaines fois et pas d’autres, ce qui est tout à fait le principe de cette prise de risque conséquente, mais qui est nécessaire. Cependant en grande partie cela a fait émerger des jeunes compagnies. La grande différence c’est que on ne doit pas attendre trois spectacles avant d’accéder à un vrai outil de création. Jean-Louis partait du principe qu’au feeling avec quelqu’un, il pouvait se dire : je vais lui donner un outil de création et on va voir comment il peut faire un premier spectacle avec de vrais moyens. Cela change non seulement l’orientation d’une carrière artistique, mais aussi les possibilités qu’on a pour faire découvrir son travail. Il faut savoir que les trois premiers spectacles ou les deux premiers en tout cas, sont ceux qui vont vous faire mettre le pied à l’étriller ou pas, le monde est cruel pour les gens qui sortent des écoles.
Tu as été comédien avant d’opter pour la mise en scène. Tu connais bien le parcours de formation artistique belge, et tu as pu travailler en tant que pédagogue dans les écoles. Que faudrait-il améliorer ou changer selon toi, dans les formations des écoles de théâtre ?
Dans les écoles il y a une paupérisation absolument incroyable. D’abord, je pense qu’elles doivent d’avantage se lier les unes aux autres, pas forcément les écoles de théâtre, mais les écoles de disciplines
différentes. Par exemple que les chanteurs d’opéra doivent apprendre à jouer et les acteurs de théâtre à chanter. Aussi, je pense qu’il faut surtout leur donner la possibilité d’avoir accès à des moyens techniques. C’est-à-dire qu’aujourd’hui un acteur ne peut pas sortir du conservatoire et travailler pour la première fois avec un micro et une caméra. Alors est-ce qu’il s’agit de réinjecter de l’argent dans les écoles, certainement, ce serait merveilleux. Mais on sait bien qu’on ne vit pas chez les bisounours. Par contre, laisser d’avantage la place aux écoles dans les théâtre subventionnés, pour donner aux élèves, notamment en dernier année, la possibilité de travailler avec des metteurs en scène invités sur de vrais plateaux, ça pourrait être déjà une belle avancée.
Tes spectacles abordent des sujets sociaux-politiques, avec souvent en toile de fond un point d’encrage existentiel… les migrations, les frontières, l’exil, les nouvelles technologie, la solitude, l’identité, la religion. Es-tu existentialiste au sens Sartre l’entendait : l’existence précède l’essence ?
Je suis plutôt brute de décoffrage à ce niveau là. J’essaie simplement de faire un portrait des êtres, de ce qu’ils sont, de la manière dont ils appréhendent le monde, mais dans un processus documentaire. Ce qui m’intéresse c’est de faire rentrer en conflit des existences différentes. Par exemple, un réfugié entre en conflit avec un médecin qui a le cancer dans mon spectacle Exils. Et je pose la question : quelle maladie ont-ils tous les deux ? Quelle maladie sociale, maladie biologique, génétique. Mon principe de dramaturgie, si j’en ai un, vise plutôt à confronter les êtres les uns aux autres. Puis c’est le travail de plateau, je cherche à donner une sensation autour de ces personnages tout en dressant leur portrait.
Les formes que peuvent prendre ton théâtre sont variées, le témoignage, le conte, le cabaret ou encore l’opéra cirque, avec peut-être l’utilisation de la vidéo omniprésente dans ton travail. Comment définirais-tu ton esthétique ? Et en quoi te pousse t-elle à aller sans cesse à la recherche de différentes formes, différents artistes ?
J’ai eu la chance assez jeune de commencer à pouvoir faire des spectacles, sans avoir fini ma formation de metteur en scène. Je crois que c’est ce qui me pousse à aller vers d’autres choses. Quand on me dit : est-ce que tu veux faire un spectacle de cirque ? Et bien forcément je mets mes conditions : je sais qu’avec le temps mon travail est balisé d’une certaine façon, mes rythmes de création et ma façon de travailler sont devenus un outil à part entière, et j’en ai besoin pour pouvoir explorer l’inconnu. Mais dans tous les cas, dès que je travaille sur un opéra avec des chanteurs, je suis moi-même dans un processus d’apprentissage. C’est peut-être l’envie de toujours être curieux, j’espère que cela durera le plus longtemps possible. Je ne sais pas si on peut définir en soit mon esthétique. Ce qui est sûr c’est que j’ai l’impression que c’est quelque chose qui est en mouvement, qui avance. Je n’ai pas fais douze spectacles mais un seul composé d’un acte I, d’un acte II, d’un acte III. Un spectacle qui avance, dans son langage aussi. Et puis on ne fait plus du théâtre comme il y a dix ans, et mon premier spectacle je l’ai fais il y a dix ans.
Peux-tu nous dire où se placent tes désirs de mise en scène aujourd’hui ? Dans un futur proche, aura t-on l’occasion de voir un nouveau projet pour Artara ?
La question opératique et musicale m’intéresse beaucoup. Je désire refaire un spectacle sans textes autour de la vie de Sylvia Plath, une auteure poétesse américaine qui s’est suicidée dans les années 60. Elle a laissé un journal intime. J’aimerais le mettre en scène avec une chanteuse et quinze femmes, toujours dans un processus de suivis avec une caméra de ce portrait. D’autre part, je continue la série Ghost Road où je fais des voyages pour écrire des spectacles. Donc il y a une partie documentaire qui va s’accentuer aussi dans mes spectacles.
La Belgique, c’est aussi l’origine du théâtre de la performance. Comment te positionnes tu face à ce théâtre dit « physique » et qu’elle place accordes-tu au travail corporel sur scène ?
A part dans Daral Shaga, je ne l’ai pas encore vraiment explorer parce que je n’en ai pas encore eu l’occasion, mais ça va venir, en tout cas dans cette notion du corps. Je ne suis pas insensible à d’autres formes mais je sais ce que je ne suis pas, je ne suis pas un chorégraphe. J’ai une forme de théâtre assez narrative. Ce qui ne veut pas dire qu’à chaque pièces ont fini par se marier et à avoir des enfants. Mais je joue avez les codes du storytelling, avec la manière dont on raconte des histoires aujourd’hui. Le cinéma américain a bercé toute mon enfance. Je m’amuse à prendre ces codes et à les démonter en quelque sorte, c’est un peu comme une grammaire à exploiter.
Lisez aussi le portrait de Fabrice Murgia en cinq chapitres.